Author and Journalist
MARC ROCHE
250ème anniversaire de la publication de la “Richesse des nations”. L’Opinion
250th Anniversary of Adam Smith “The Wealth of Nations”, L’Opinion
Le 7 mars 2026, la Grande-Bretagne va célébrer le 250e anniversaire de la publication de La nature et les causes de la richesse des nations d’Adam Smith, le père du libéralisme économique qu’il voyait comme « le libre-échange, c’est la paix ». A cette occasion, notre chroniqueur Marc Roche explore les vestiges des lieux emblématiques ou méconnus de son histoire en vue de présenter l’ancien et le nouveau visage de ce courant de pensée qui prône la défense des droits individuels.
Pèlerinage au berceau du libéralisme : le portrait remisé d’Adam Smith, à la National Portrait Gallery
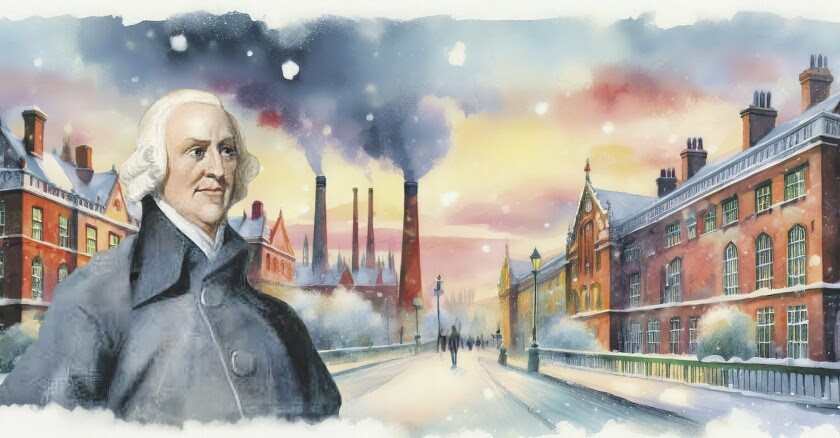
La National Portrait Gallery sise sur Trafalgar Square abrite une extraordinaire collection de portraits des Britanniques les plus célèbres. L’économiste-philosophe Adam Smith devrait figurer en bonne place dans ce panégyrique offrant un survol de l’histoire du royaume, d’Henri VIII à nos jours. Après tout, l’auteur de la Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations, dont on célèbre le 250e anniversaire de la publication l’an prochain, est le père du libéralisme économique.
Mais, il faut monter dans la salle « Régence, romantique et réforme » perdue au troisième étage, pour constater que l’hommage de la nation au héros du libre-marché fait piètre mine : une simple gravure au crayon datant de 1790 montrant le natif de la bourgade écossaise de Kirkcaldy devant son ouvrage-phare. A l’exception d’une statue financée par des dons privés, érigée sur le Royal Mile à Edimbourg où il est mort en 1790, il ne reste guère de traces du théoricien de la division du travail. L’intéressé a été balayé par les économistes star de l’ère contemporaine qu’il avait inspiré, à commencer par Friedrich Hayek et John Maynard Keynes, et aujourd’hui par les pionniers de l’intelligence artificielle.
Ultime affront, la figure emblématique de la liberté des échanges et des prix a été remplacée au verso du billet de banque violacé de 20 livres par le portrait du peintre romantique William Turner ! Nul n’est prophète en son pays et encore moins en son temps. Dans le berceau même de la révolution industrielle considéré comme la deuxième nation la plus libérale en Europe après la Suisse, la moindre trace de l’éternel affranchi se transforme en précieuse relique.
L’icône planétaire est plus que jamais d’une actualité brûlante. Droits de douane imposés par Donald Trump, taxation des nantis, réduction des prestations sociales, immigration…
Pour en avoir le cœur net, direction le quartier des bâtiments abbatiaux du palais de Westminster abritant la Mère des Parlements. Engouffrons-nous dans les ruelles où sont nichés les trois centres d’études de la philosophie libérale : l’Adam Smith Institute, le Center for Policy Studies et l’Institute for Economic Affairs. Le gardien de la flamme, l’inventeur du thatchérisme et le tenant du courant libertaire. Les centres du savoir sont installés à quelques encablures de Smith Square, élégante petite place bordée de platanes où un hôtel particulier de style géorgien accueille le siège du parti conservateur.
Cette proximité me laisse perplexe. La philosophie smithienne est plutôt associée au parti libéral (devenu « lib dems ») qu’aux tories de Disraeli. Mais on y reviendra.
En attendant, comme un Candide, je pars à la découverte des sources du libéralisme économique en compagnie de témoins et de monuments complices : telle est l’ambition des dix articles de cette série d’hiver dont la première livraison est tout naturellement consacrée à Adam Smith. L’icône planétaire est plus que jamais d’une actualité brûlante. Droits de douane imposés par Donald Trump, taxation des nantis, réduction des prestations sociales, immigration…, on frôle le trop-plein. Ajoutons 1776, l’année de l’indépendance des Etats-Unis qui ont porté sur les fonds baptismaux le libre-marché et l’entreprenariat chers à l’inventeur de l’économie politique.
D’entrée, je remarque que les « think tanks » anglais font piètre mine comparée aux poids lourds de K Street, l’artère de Washington où sont nichés bon nombre d’experts, de lobbystes et de consultants. L’Adam Smith Institute ressemble à la turne d’un potache. Les chercheurs et administratifs, jeunes, dynamiques et effrontément sympathiques, sont collés-serrés dans une salle aux meubles déglingués qui pourrait servir de décor à un film de Wim Wenders, la fumée de cigarette en moins. Comme si depuis le XVIIIe siècle rien n’avait été refait hormis la peinture. Les drapeaux écossais, américain et britannique, quelques photos et deux petits bustes rendent hommage au moraliste qui, malgré son ode à la prospérité, avait mis en garde contre les effets pervers de la cupidité dans son autre classique, La Théorie des sentiments moraux . Nobody is perfect !
Fondé en 1977, deux ans avant la victoire de Margaret Thatcher, le laboratoire de la doctrine libérale a été décrit par son président et cofondateur, Madsen Pirie : « Nous sommes une usine à idées considérées au départ à la frontière de la folie. Sans trop s’en rendre compte, elles se transforment en nouvelles politiques ». A l’exemple des privatisations et du monétarisme pour contrôler l’inflation, deux stratégies phares de la « Dame de fer » pour sortir « l’homme malade de l’Europe » de l’ornière.
Mais attention, ne lui mentionnez pas comme je l’ai fait que le libéralisme, en pleine ascension sous Thatcher, Reagan et Delors (le marché unique européen), est désormais en crise des deux côtés de l’Atlantique. Mon constat est accablant
Mitchell Palmer se présente comme le gardien de la flamme du champion du laissez-faire, de l’ordre naturel des choses, de la primauté de l’intérêt personnel sur le collectif. Sa dévotion à Adam Smith est le résultat des réformes « remarquables » de libéralisation de l’économie réalisées dans les années 1980 par le gouvernement de gauche de la Nouvelle-Zélande où il est né. Les mots d’ordre de son maître à penser – la paix, l’impôt bas et une justice tolérable – trouvent toujours grâce aux yeux de notre zélote pour qui les dirigeants du moment manquent de courage pour défendre la foi anti-étatique.
Foi que partage l’Adam Smith Institute au sein de l’association libertaire de droite, le réseau Atlas, regroupant 600 groupes de réflexion d’une centaine de contrées. A commencer par les grosses montures à la bannière étoilée, l’Heritage Foundation, le Cato Institute, la Société du Mont Pèlerin et autres missionnaires du trumpisme soucieux d’étendre la théorie du marché à tous les aspects de l’activité humaine.
Mais attention, ne lui mentionnez pas comme je l’ai fait que le libéralisme, en pleine ascension sous Thatcher, Reagan et Delors (le marché unique européen), est désormais en crise des deux côtés de l’Atlantique. Mon constat est accablant. La mondialisation est jugée néfaste. La politique industrielle, les syndicats et le protectionnisme commercial sont à l’affiche partout. L’heure est à la hausse de l’impôt. La re-réglementation explose.
La génération Z, les 18-24 ans, privée d’opportunités lorgne vers les extrêmes, refuse la libre circulation et défend l’identité nationale, des préceptes aux antipodes de la modération en toutes choses prônée par Smith, cosmopolite et tolérant. Face aux soubresauts financiers, géopolitiques et sociétaux, l’électorat réclame davantage de protection à la puissance publique.
La génération Z, les 18-24 ans, privée d’opportunités lorgne vers les extrêmes, refuse la libre-circulation et défend l’identité nationale, des préceptes aux antipodes de la modération en toutes choses prônée par Smith, cosmopolite et tolérant
Aussitôt sa voix au fort accent des Antipodes résonne : « N’essayez pas à tout prix de mettre des chapeaux sur les portemanteaux ». A l’écouter, le courant de pensée progresse de nos jours non seulement aux Etats-Unis mais en Europe de l’Est, en Amérique du Sud et en Afrique.
A la recherche d’un peu plus de nuances, rendez-vous est pris avec une vieille connaissance, Roger Bootle. Le président de Capital Economics, cabinet de conseil en recherche macroéconomique et chroniqueur hebdomadaire au quotidien conservateur Daily Telegraph , cumule toutes les légitimités qui font de lui un beau fleuron du libéralisme. Et c’est d’ailleurs ainsi qu’il se présente en me recevant dans sa belle maison de briques rouges du quartier chic de Chelsea.
Gare à la déception. Je m’attendais à un capharnaüm de livres, de rapports, de tiroirs débordant de graphiques annotés. Le cadre monacal et dénué de chaleur est destiné à projeter une image de sérieux. Mon interlocuteur d’une politesse feutrée, emprunté d’humour en demi-teinte, me regarde avec un rien de compassion en pensant que je dois être le type même de l’ergoteur français habité de desseins ambitieux, de concepts déconcertants et regrettablement sujets aux doutes métaphysiques. Lui travaille dans le réel, tout simplement.
Roger Bootle n’y va pas par quatre chemins. « Le problème du libéralisme en général est que l’être humain n’est pas motivé que par sa propre prospérité. Il a besoin d’appartenir à une communauté. Dans un univers compétitif, égoïste, où trouver le sens d’appartenance ? Smith a donné une dimension sociale au capitalisme. Il estime qu’il faut un minimum de règles de bonne conduite des agents économiques pour que le système fonctionne, à l’inverse des économistes américains de son époque, partisans de la liberté à tout vent ».
J’ai choisi de faire confiance à l’arbitraire. A chaque interviewé, je demande de me suggérer la suite. L’idée amuse Roger Bootle qui me conseille de demander un rendez-vous avec l’ex-première ministre, Liz Truss : « Elle doit s’ennuyer ferme ». En effet, sa chute vertigineuse après seulement quarante-neuf jours au pouvoir à la suite du torpillage par le marché obligataire de son mini-budget d’octobre 2022 illustre le défi auquel l’école libérale est actuellement confrontée.
La réponse de Liz Truss est favorable. Rendez-vous est pris à Mayfair, l’oasis londonien grand chic grand genre fait pour les riches.
Pèlerinage au berceau du libéralisme : mes vingt-neuf minutes et cinquante-cinq secondes avec Liz Truss
Publié le 18 décembre 2025 à 08:56 – Maj 18 décembre 2025 à 12:18
L’usage impose encore de lui donner du « Madame la Première ministre » même si elle n’est restée que 49 jours au 10 Downing Street. La poignée de main de Liz Truss, au pouvoir entre le 6 septembre et le 25 octobre 2022, est décidée. Le sourire est excessif, au point de se figer comme s’il était de commande, et le regard pugnace. Le visage est anglais, la peau laiteuse, une ossature d’une grande finesse et le teint délicat.
« Les yeux de Caligula et la bouche de Marilyn Monroe », la définition naguère appliquée par François Mitterrand (avec quels rebondissements polémiques !) à Margaret Thatcher, lui irait comme un gant. Enfin presque. L’ancienne leader de la majorité tory porte d’ailleurs un tailleur bleu, l’une des tenues préférées de « Maggie », son modèle autoproclamé en politique, avec qui elle partage, outre la voix affectée, le même caractère d’acier de celle que personne ne réussit à faire changer d’avis lorsqu’elle estime avoir raison.
Quel talent ! Le livre de Liz Truss, Dix ans pour sauver le monde. Leçons de la seule vraie conservatrice dans la salle, est négligemment posé sur la table de travail dépourvue du moindre objet personnel du vaste bureau niché dans un espace de co-working. La moquette sent le bel immeuble d’un beau quartier. Il s’agit de son premier entretien à la presse française. Elle s’est engagée à dévoiler à l’Opinion ce qu’elle a refusé de faire jusqu’à présent aux médias britanniques : expliquer les raisons de l’échec de la seule vraie expérience libérale en Occident au cours des dernières années.
Liz Truss voudrait paraître tranquille mais on la sent tendue, avec ce petit rire contraint qui cache mal son agacement. Cette personne est à manier avec précaution… Pour l’amadouer, ma première question – gracieuse – concerne l’héritage d’Adam Smith dont le 250e anniversaire de la parution de Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations sera célébré en mars.
« En mettant l’accent sur l’intérêt individuel transcendant le collectif cher à la gauche, Smith est plus que jamais d’actualité. En tant que cheffe du gouvernement, ma stratégie était de promouvoir la libre-entreprise, la concurrence, le secteur privé en réduisant la voilure de l’Etat. Mais contrairement à ce remarquable penseur, je suis hostile à la libre-circulation de la main-d’œuvre », dit-elle en désignant le buste du père du libéralisme posé sur une étagère.
Après cet aimable zakouski, nous entrons dans le vif du sujet : son fameux minibudget « uber libéral » présenté le 23 septembre 2022. L’annonce de baisses d’impôt sur le revenu pour les plus riches, non financées quitte à creuser un déficit budgétaire abyssal, a plongé la corbeille dans la tourmente. La diplômée d’Oxford passée par la Shell a été « défenestrée » par ses députés qui l’ont remplacée manu militari par son ennemi juré, le centriste Rishi Sunak. Emportée par le raz-de-marée électoral travailliste lors du scrutin de juillet 2024, la pauvre a perdu son siège de députée du Norfolk après une décennie de bons et loyaux services.
« Ma philosophie était révolutionnaire. Je n’ai jamais cru aux glissières de sécurité », insiste à l’appui de sa démonstration, celle qui a occupé les plus hautes fonctions ministérielles avant de succéder à Boris Johnson. Il y a chez Truss cette insensibilité au doute et cette certitude de ne pas se tromper dont l’aveu lui échappe lors de notre échange et que partagent rarement les bienheureux. « Post-Brexit, il fallait changer de braquet en absorbant des stéroïdes plutôt que du valium mais mon ambitieux projet a été saboté par l’Etat profond (le dark state) qui s’est débarrassé d’un premier ministre démocratiquement élu ».
« Quand vous voulez libéraliser l’économie, les banques centrales dirigées par des bureaucrates n’ayant de comptes à rendre à personne sont prêtes à vous jouer de sales tours en vue de miner votre action », assure Liz Truss à l’Opinion
De nos jours, la croisée du laisser-faire comme on n’en fait plus se nourrit volontiers aux sources conspirationnistes. A l’écouter, les partisans du statu quo – les hauts fonctionnaires, les anti-Brexit, les classes professionnelles urbaines, le Financial Times et la frange modérée des élus conservateurs – étaient prêts à tout pour protéger leurs propres intérêts en empêchant l’avènement d’une classe d’entrepreneurs. Le blob visqueux, ce réservoir de spécialistes dans lequel les supporters du juste milieu sont recrutés, a eu sa tête, selon elle.
« Quand vous voulez libéraliser l’économie, les banques centrales dirigées par des bureaucrates n’ayant de comptes à rendre à personne sont prêtes à vous jouer de sales tours en vue de miner votre action ». Le premier accusé de ses déboires, dit-elle, est la Banque d’Angleterre tapie au centre de la toile d’araignée tissée par l’establishment pour empêcher des réformes d’envergure.
L’institut d’émission est en grande partie responsable du chaos financier qui a eu raison de la « Trussonomics ». Aux yeux de l’imprécatrice, la vente massive par la Banque d’obligations d’Etat la veille de l’annonce de son mini-budget a eu l’effet de faire chuter leur valeur dans le portefeuille des fonds de pension et de propulser le taux d’emprunt britannique au plus haut.
Au Royaume-Uni comme aux Etats-Unis, le moindre microbe a sa fondation et ses soirées de gala. Liz Truss n’est pas en reste. Elle siège au sein du groupe de conseillers internationaux de la « Growth Commission », la commission pour la croissance.
Ce cénacle rassemble à ses côtés les ex-Premiers ministres slovène, tchèque, australien, polonais et autrichien très marqués à droite qu’elle a fréquentés dans les allées du pouvoir. Parmi ses fans figurent la nationaliste Sanae Takaichi, l’actuelle Première ministre du Japon, et Steve Bannon, le facho qui fut l’éminence grise de Donald Trump. L’Etat est bien sûr la cible d’un virulent procès en gabegie et en inefficacité. Comme l’affirme la frange réactionnaire trumpiste dont Truss est proche, l’immigration incontrôlée et le virus « woke » doivent être enrayés. Le consensus est synonyme d’abandon des convictions et des principes.
En limogeant dès son installation à « Number Ten » le directeur du Trésor qui à ses yeux allait lui mettre des bâtons dans les roues, elle s’est mis à dos les élites qu’il faut ménager quand on rue dans les brancards
Comment réagit aujourd’hui la City face à l’échec de Liz Truss ? Rendez-vous est pris avec une courtière en bons d’Etat britanniques au Café Brera niché à l’entrée de Cabot Square, point d’ancrage traditionnel des traders. En cette fin d’après-midi, l’établissement est bondé, les lumières sont tamisées, la musique couvre les conversations.
Liz-la-maudite a commis trois erreurs fondamentales, estime mon interlocutrice, habillée d’un ensemble noir, veste et jupe, et d’un chemisier en soie blanc, l’uniforme de la place. Tout d’abord, sa précipitation à révéler les dégrèvements fiscaux sans les accompagner d’un plan de réduction des dépenses tandis que le pays était endetté jusqu’au cou a été à l’origine de la défiance des opérateurs.
Ensuite, à l’inverse du négoce d’actions fécondé par le risque, le marché obligataire recherche rendement et sécurité fondés sur une politique économique crédible. Enfin, en limogeant dès son installation à « Number Ten » le directeur du Trésor qui à ses yeux allait lui mettre des bâtons dans les roues, elle s’est mis à dos les élites qu’il faut ménager quand on rue dans les brancards.
« Nous sommes le meilleur ami des citoyens en empêchant les élus de faire des bêtises » : la spécialiste du « bond market » a des fourmis dans les jambes et me conseille de rencontrer l’un de ses amis, David Colville, qui dirige un think tank créé en 1975 par Margaret Thatcher. Sa précipitation à clore notre tête-à-tête est normale. Chaque minute passée à ne pas spéculer lui fait perdre de l’argent. Une professionnelle, quoi.
Le directeur du Centre for Policy Studies partage le même jugement négatif sur l’arroseuse arrosée malgré l’usage du parapluie complotiste. « Au départ, je me suis bien sûr réjoui de l’arrivée aux affaires de l’une d’entre nous. Mais la nouvelle venue n’était pas sérieuse et de surcroît autiste. Elle aurait dû expliquer aux gens, de manière didactique, que la doctrine libérale pouvait leur offrir une meilleure existence au lieu de les brusquer ».
Liz Truss était prisonnière de ses convictions tranchées. A l’opposé, « Maggie » Thatcher s’était drapée dans le retour aux valeurs vieux jeu rassurantes du libéralisme d’antan chères à son père épicier, l’ambition, la prudence et l’exacte mesure des rapports de force politiques et sociaux. La différence est instructive.
L’interview de Liz Truss était prévue pour durer une demi-heure. A vingt-neuf minutes et cinquante-cinq secondes, elle me plante là avec mes questions, se lève et me tend la main. Pour ce qui est de mon enquête, je lui demande conseil pour l’épisode suivant consacré au commerce international. « J’ai l’homme qu’il vous faut, le président de notre commission, Shanker Singham. C’est un vrai génie ». Ian, l’attaché de presse au teint ton cireux (sans doute dû au travail) est prié d’organiser le rendez-vous.
L’ethnologue nomade du libéralisme quitte le 20 Curzon Street en éprouvant une sorte de vertige. L’édifice abritait jadis le MI5, le contre-espionnage de Sa Majesté, comparé à un « cirque » par John Le Carré. Qu’aurait pensé George Smiley de Liz Truss, lui qui n’était qu’un gentleman ?
Pèlerinage au berceau du libéralisme : Tower Bridge, pont impérial(iste)
Publié le 21 décembre 2025 à 17:45
L’ex-première ministre conservatrice Liz Truss admire Shankar Singham et, au risque d’indisposer, l’a fait savoir à plusieurs reprises lors de notre rencontre (lire le volet 2) comme si toute idée produite par ce cerveau exceptionnel méritait d’être prise en considération.
Patatras ! Au lieu d’un rendez-vous physique que je demande aux acteurs du libéralisme interrogés dans le cadre de cette série, l’expert du commerce international m’offre une courte réunion en visio-conférence sur l’application Zoom. C’est à prendre ou à laisser. En cette fin d’année, son agenda est saturé.
L’entregent de celui qui a été l’un des architectes du partenariat transpacifique (1), visant à intégrer les économies des régions Asie-Pacifique et Amérique, ainsi que du traité avorté entre les Etats-Unis et l’Union européenne, il est vrai, en impose.
Partisan déterminé des transactions sans entraves, notre économiste se réjouit d’emblée de la diminution des obstacles douaniers, des quotas et des subventions réalisée sous la houlette des traités multilatéraux (2) signés depuis 1947.
Toutefois, l’allègement des barrières a maintenu en place des systèmes régulatoires intérieurs rigides et une faible protection du droit de propriété intellectuelle ou d’investissement. Or, ces deux distorsions affectent 80 % du PNB mondial par tête. « La cause du libéralisme en a souffert dans la mesure où le public a le sentiment justifié de ne pas avoir profité de la mondialisation comparée aux élites qui se sont enrichies », insiste Shankar Singham, chiffres à l’appui, sans aucune note devant lui.
Donald Trump a rétabli les néfastes rapports de force entre nations en relevant les droits de douane américains. Faute d’obtenir les accords bilatéraux souhaités, Washington ne cesse de reporter ses ultimatums. L’effet est dévastateur. Le jeu diplomatique de l’occupant de la Maison Blanche est incompréhensible. Les incertitudes du commerce, les perturbations dans les chaînes d’approvisionnement, la nervosité des chancelleries… tout cela au nom de la volonté d’aligner les contrôles à l’exportation des partenaires sur ceux des Etats-Unis.
La réplique de Shankar Singham, dont le débit ultra-rapide est destiné à éviter les interruptions, fait mouche. Il se soucie comme d’une guigne que la stratégie de Trump soit protectionniste. Qu’importe que le chantre de l’hégémonie de la bannière étoilée entende défendre l’industrie américaine et regarnir les caisses de l’Etat ! A l’écouter, le président est un vrai réformiste.
Son dessein de corriger les dysfonctionnements des échanges mondiaux en utilisant la taille et l’attractivité de l’économie américaine est tout à fait logique. Les prévisions pessimistes de ses détracteurs seront démenties car le pire n’est pas toujours sûr, tel est le leitmotiv de ce trumpiste sans état d’âme selon lequel l’objectif final de son surhomme est d’éradiquer les tarifs sur le long terme. A ce niveau de confiance, c’est du grandiose.
« Competere » (« concurrence » en italien) est le nom du cabinet de recherche libéral que dirige cet universitaire distingué. Le think tank réalise depuis 2010 un indice des pays ayant œuvré avec succès à l’élimination des anomalies économiques. Ses collaborateurs dressent l’état des lieux de la planète, agitent le tout, passent au mixer et vous avez Hongkong, Singapour et la Nouvelle-Zélande en tête du classement 2024. Les Emirats arabes unis et la Tchéquie, en forte progression, mordent aux jarrets du trio.
La France ? Une bien triste 22e place due au manque de flexibilité du marché du travail, au poids de l’Etat et à la paralysie politique actuelle. L’Hexagone n’est pas prêt aux sacrifices nécessaires qu’il résume d’une phrase : il faut réduire les impôts, les dépenses publiques et les réglementations administratives.
Le Zoom se termine. J’ai choisi de faire confiance à l’arbitraire en demandant à mes interlocuteurs de me conseiller l’étape suivante de mon reportage. Pour Shankar Singham, pas de doute, une visite de la City s’impose toutes affaires cessantes afin de saisir l’essence du libéralisme. Et pour découvrir le skyline de l’arrondissement du business, rien ne vaut la longue passerelle vitrée de Tower Bridge surplombant la Tamise.
Pèlerinage au berceau du libéralisme : la statue oubliée de Richard Cobden, le héros de Napoléon III
Publié le 22 décembre 2025 à 11:48
Le jeune grunge sur skateboard vous file entre les pattes à la vitesse du son. Le concepteur de tatouages vante son produit à pleine voix comme une marchande des quatre saisons. Le prédicateur évangéliste noir brandissant une pancarte « repentez-vous » jouxte des mendiants ou une surprenante mini manifestation anti-pédophiles de féministes à la coiffure mohican. A la sortie de la station de métro Camden Town, dans le nord de Londres, le spectacle est sans cesse et partout.
Pour se rendre à la statue de Richard Cobden, il faut descendre une large avenue bordée de commerces minables et de grands ensembles, et contourner un mémorial militaire dédié aux soldats prisonniers des Japonais morts lors de la construction du pont de chemin de fer de la rivière Kwai.
Richard Cobden, né le 3 juin 1804 et décédé le 2 avril 1865, était un industriel anglais, homme d’État radical et libéral impliqué dans deux grandes campagnes en faveur du libre-échange, l’Anti-Corn Law League et le Cobden Chevalier
Le monument de pierre beige foncé achevé en 1868 a été élevé sur une place obscure. L’œuvre d’art est en mauvais état, nez cassé, excréments de pigeons et détritus. L’industriel et parlementaire libéral a été laissé à l’oubli dans la mémoire nationale.
Triste sort pour l’un des plus grands réformateurs d’outre-Manche. Il est à l’origine de l’abrogation en 1846 des « corn laws » (lois sur le blé) protectionnistes imposant des droits de douane élevés sur les céréales importées en vue de protéger les grands propriétaires terriens locaux.
Le maintien du prix du pain à un niveau artificiellement élevé avait provoqué périodiquement des émeutes de la faim. Dans la foulée de l’abandon de la loi inique, l’Acte de navigation en vertu duquel seuls les navires arborant l’Union Jack pouvaient transporter les marchandises « made in England », avait été supprimé.
Belle surprise, le front de la statue porte l’inscription « érigée par souscription publique dont Napoléon III fut le principal contributeur ». L’empereur des Français avait voulu ainsi remercier le co-auteur avec le sénateur Michel Chevalier de l’accord de libre-échange franco-britannique signé en 1860. Le traité avait supprimé les barrières aux importations des matières premières et de la majorité des produits alimentaires.
Libéral dans l’âme malgré son régime autoritaire, Napoléon III avait ouvert les frontières à la concurrence étrangère. Soudain, la mélancolie nous étreint. Après l’écroulement du Second Empire en 1871, il s’était réfugié outre-Manche où il mourut deux ans plus tard.
Son unique fils, le prince Louis Napoléon Bonaparte, officier dans l’armée de Sa Majesté, fut tué par les Zoulous en 1879. Le dernier monarque de l’Hexagone n’avait jamais caché son admiration pour l’épopée fantastique de la minuscule Angleterre.
Fort de son fer et de son charbon, le royaume avait édifié un empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais grâce aux richesses énormes de ses dominions et colonies ainsi qu’à la maîtrise des océans. By Appointment to Her Majesty Queen Victoria.
L’absence de reconnaissance nationale de celui qui, né pauvre, était devenu un self made man millionnaire à 32 ans grâce à la confection du Calico, un tissu fabriqué à partir de coton non teint, reste un mystère. Certes, l’homme souffrant mal la contradiction avait mauvais caractère. Néanmoins, il avait réussi la gageure d’unir la droite et la gauche d’Albion dans le même enthousiasme.
Pour les conservateurs modérés, cet ennemi de la révolution était le symbole de la victoire de la bourgeoisie sur l’aristocratie. Se présentant volontiers comme un industriel de Manchester, le natif du Sussex, comté du sud, au lieu de savourer sa fortune, avait réfléchi aux vertus du commerce international sans entraves : objets manufacturés et houille contre produits de base à bon marché.
Il n’avait rien d’un altruiste préoccupé de la souffrance du monde ouvrier. La Ligue contre les lois sur les blés qu’il avait fondée avec son compère John Bright, avait réclamé et obtenu du pain moins cher, non pour lutter contre la pauvreté mais pour limiter les salaires et les coûts de revient en vue de remplir les caisses.
Aussi, à l’image de son maître à penser Adam Smith, défenseur impitoyable du laissez-faire dans son ouvrage de référence, « la richesse des nations », dont le 250e anniversaire de la publication est commémoré au printemps prochain, le « Mancunian » avait associé l’absence de droits douaniers à la concorde.
« Influencé par Smith, Cobden pensait que si les nations se concentraient sur le négoce au lieu de se faire la guerre, la paix serait éternelle. A ses yeux, soutenu par une armée et une flotte puissantes, l’ordre mercantile au nom duquel les Etats mettaient en place des obstacles aux importations était un résidu de l’Ancien Régime », explique à l’Opinion l’historien Miles Taylor, auteur de The European Diaries of Richard Cobden, le recueil des carnets personnels de son héros.
Les progressistes mettaient également Richard Cobden sur un piédestal. L’intéressé était hostile à la colonisation, jugée contre-productive et onéreuse à long terme. Par ailleurs, si sa condamnation de l’impérialisme comme de la force militaire et sa défense de la liberté d’expression lui avaient valu la haine des milieux réactionnaires, Karl Marx l’adulait.
Aussi comme l’atteste l’abandon des « corn laws », le libéralisme est par définition l’ennemi des féodalités protégées bénéficiant de privilèges et de rentes empêchant des concurrents d’entrer sur leur secteur d’activité.
Quelle est la pertinence de son œuvre maintenant ? « A première vue, cette figure historique n’a rien à nous apporter de nos jours. Mais à y regarder de près, Cobden expliquerait facilement les batailles actuelles, géopolitiques et économiques. Il aurait saisi l’importance des belligérances tarifaires et le rôle de la société civile ou du Parlement dans la négociation des traités entre nations. », réplique Miles Taylor.
Autre actualité de Cobden, il était favorable à la libre-circulation non seulement des marchandises mais des hommes. Une question devenue explosive à l’heure du débat sur l’immigration et du retour à l’Etat nation et aux frontières.
Rien n’illustre mieux l’atmosphère nationaliste ambiante que la disparition de son nom de la devanture du pub situé à quelques encablures du mausolée. Longtemps tenu par des Irlandais, l’établissement a été rebaptisé Phenix par la nouvelle direction qui s’est drapée dans la croix Saint-Georges, drapeau de l’Angleterre récupéré par l’extrême droite. Si plus de cent trente rues, places, avenues dans la capitale portent le nom de Victoria, deux seulement sont dédiées à « Richard-le-magnifique ».
Comment atténuer la déception de ma visite à Camden Town ? Le Reform Club devrait me permettre de terminer le périple Cobden sur une bonne note. Comme il sied, le rénovateur a été membre de ce creuset de la vie intellectuelle au XIXe siècle.
Le cercle très sélect et exclusif a été fondé en 1836 par des Whigs, libéraux et réformistes, à l’issue de l’octroi du droit de vote à la classe moyenne masculine des villes industrielles émergentes (mais en laissant de côté la classe ouvrière).
Le club peut se targuer d’être l’unique musée au monde consacré au grand homme, affirme mon guide, Peter Urbach. Son grand portrait montre le zélote assis à son bureau, le front volontaire mais l’allure lasse. La collection de reliques – correspondance, porcelaines et mugs, médailles gravures et bustes, petits et grands et j’en oublie – est riche.
A l’évidence, le sanctuaire du débat d’idées a pardonné à l’un de ses plus illustres adhérents d’avoir claqué la porte en raison de son opposition à l’action belliciste d’un honorable adhérent, le Premier ministre Lord Palmerston en personne. Cobden était un farouche opposant à la participation de son pays au conflit de Crimée, entre 1853 et 1855, au côté de l’Empire ottoman et de la France contre la Russie.
Le fabuleux pari de Phileas Fogg d’un tour du monde en quatre-vingts jours est né dans la « Card Room » du Reform lors d’une partie de whist et c’est ici, au 104 Pall Mall, qu’il revint avant que le délai fatidique se soit écoulé. Jules Verne n’avait jamais mis les pieds au Reform. Il s’était inspiré du critique français Francis Wey qui avait mentionné avec admiration le club dans son essai, « Les Anglais chez eux », à la suite de l’une de ses visites en 1854.
Par étourderie, j’ai oublié de demander à Urbach de me souffler le nom du prochain interlocuteur, suivant la règle que je me suis imposée pour cette série d’articles. La chaîne des interviewés est rompue.
Puisqu’on n’y peut rien, autant se replonger dans le roman de Verne confortablement installé dans un fauteuil profond, dans l’atrium du Reform. Phileas Fogg et son domestique Passepartout montent dans un cab qui gagne la gare de Charing-Cross.
A 20 heures, le carillon de Big Ben sonne les huit coups qui résonnent dans les couloirs silencieux de la Chambre des Lords voisine. Tout à coup, mon prochain rendez-vous fait tilt. Lord Elliott, l’un des grands espoirs de la nouvelle vague libérale, of course. Je connais bien le jeune pair, très bien même, et « trop » bien sans doute…
Pèlerinage au berceau du libéralisme : le titre de baron de Lord Elliott, l’étoile montante de la seule loi du marché
Publié le 23 décembre 2025 à 15:59
« Déniche-moi le jeune économiste libéral d’outre-Manche qui monte ! » Telle était la consigne de la direction de l’Opinion en discutant le contenu de cette série. Comme les chefs ont toujours raison, le globe-trotter du libéralisme est parti à la chasse de la perle rare.
Graal. Vu l’emprise des tenants du besoin d’Etat et de l’encadrement du capitalisme sur l’enseignement supérieur des sciences économiques, la quête du Graal s’est avérée une vraie gageure. Heureusement, Hachards, ma librairie favorite de Londres, a eu la bonne idée de mettre en évidence sur la table des essais économiques un livre au titre on ne peut plus alléchant pour un explorateur lancé sur les traces du libéralisme, Prospérité via la croissance (« Prosperity through growth »).
En feuilletant la minutieuse investigation, le plexus solaire se noue. Si le présent gouvernement travailliste poursuit sa politique de hausse des dépenses et de l’impôt, le royaume sera rattrapé par la Lituanie en 2030, la Pologne en 2034 et la Turquie en 2040. Lord Elliott est l’un des quatre auteurs (*) de ce brûlot.
L’intéressé fera parfaitement l’affaire.
Tout d’abord, à 47 ans, Matthew Elliott est l’un des plus jeunes membres de la sage assemblée dont la fougue tranche avec l’allure pépère de ses collègues. Par ailleurs, propulsé en 2023 à la Chambre des Lords, l’honorable a choisi le titre de baron de Mickle Fell, un sommet de 788 mètres dans les Pennines. Imaginez en France un sénateur affublé de la distinction du mont Saint-Cyr, l’équivalent dans le Mâconnais !
Excentricité. Au-delà de la touche d’excentricité qui convient, le bonhomme est une vieille connaissance. Le brillant directeur-général de la campagne du « Vote Leave » en faveur du Brexit a été l’un de mes excellents informateurs lors du référendum européen de 2016.
En tant que correspondant du Monde, j’ai également couvert les deux autres victoires de l’influenceur politique, comme on dirait de nos jours : le refus d’introduction d’une partie de proportionnelle dans le système électoral uninominal à un tour et le rejet de l’adhésion de la livre sterling à l’euro. Mon ex-indic n’a rien, mais vraiment rien, du météore brusquement apparu dans le ciel londonien.
Ce 13 novembre, His Lordship ouvre le débat de la chambre haute consacré à l’impact de la stratégie économique de l’équipe Labour sur la croissance et l’emploi. Son constat est sans appel. En l’absence d’une baisse drastique des prix de l’énergie, de la diminution des charges patronales et du retour des exemptions fiscales au profit des milliardaires étrangers, le pays de Charles III est condamné à redevenir « l’homme malade de l’Europe » comme on disait de l’Empire ottoman. Il faut permettre à nouveau au peuple de s’enrichir !
Sous les plafonds chamarrés, leurs seigneuries écoutent avec attention. Aucun notable ne jacasse dans un coin ou ne s’endort sur les bancs de cuir rouge. Le credo de l’orateur lucide et calme trouve un large écho dans la petite salle sous forme de chapelle dont les murs racontent l’histoire d’un peuple orgueilleux si singulier que Victor Hugo le comparait aux Chinois.
Après le débat, je le retrouve au bistrot de la Chambre des Lords dont l’atmosphère feutrée et le décor sans âge fait de boiseries sombres est propice aux confidences entre gens de bonne compagnie. Grand, mince, cheveux courts, l’intéressé n’a guère changé depuis notre dernière rencontre en avril 2019 à bord du « Brexit Express », le voyage en train à vapeur parcourant les bastions du vote en faveur du retrait.
De l’avis général, le Brexit ne fut ni le désastre prédit par les « Remainers », ni le succès prédit par les partisans du largage des amarres. Alors score nul, balle au centre ?
Au vu des longues et difficiles négociations entre Londres et Bruxelles, mon interlocuteur se déclare « modérément » satisfait de l’issue sur le long terme. Albion a repris sa liberté en main mais sans tirer profit jusqu’à présent des opportunités offertes par ce départ en raison de la frilosité du milieu politique.
La frange libre-échangiste des partisans de la sortie, à laquelle appartenait Matthew, rêvait de transformer la City en un « Singapour-sur-Tamise ». Singapour est l’une des places financières les plus dynamiques au monde par le truchement d’un environnement sans contrainte, ni entrave. Le micro-Etat est une gigantesque zone off-shore prête à tous les accommodements.
A écouter Mylord, le raz-de-marée électoral de Boris Johnson en 2019 a eu raison de cette belle promesse. En redécouvrant les vertus de l’Etat providence et de l’argent magique, la coalition victorieuse regroupant les conservateurs traditionnels et le « red wall » (muraille rouge) ouvrier a enterré le grand dessein extraterritorial. S’ajoute l’hostilité des Vingt-Sept à la création d’un paradis fiscal doté de tous les atours aux portes de l’Europe.
Le personnage se présente comme le porte-parole « à 100% » de l’idéologie du libre-marché : « Dans les années 1970 et 1980, les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont connu une phase libérale car ils étaient très malades. Je ne souhaite bien sûr pas l’apocalypse mais être confronté à une grave crise peut rendre service ».
Prudemment, il pèse, soupèse, chacun de ses mots, chacun de ses actes. Dans les discours du diplômé de la London School of Economics, tout est dit et même prédit en filigrane. La débâcle du mini-budget présenté en septembre 2022 par Liz Truss, une allumée débarquée après 49 jours au pouvoir, a traumatisé la droite. Face aux nuages qui s’assombrissent, le benjamin du sérail veut incarner davantage la troisième voie de Tony Blair plutôt que l’orthodoxie thatchérienne. Le gel des dépenses sociales au lieu d’une réduction brutale est désormais à l’affiche.
Lord Elliott est convaincant dans sa vision réaliste du libéralisme. Afin de la défendre, il a créé la Jobs Foundation en 2021. Officiellement, cette organisation caritative au-dessus de la mêlée partisane regroupe plus d’un millier de grands et petits patrons en vue de promouvoir la formation professionnelle. Mais en fait, son objectif est d’occuper le terrain politique. Comme en France, les PDG britanniques souhaitent aujourd’hui faire entendre leurs voix dans les médias comme au Parlement.
La Jobs Foundation, n’est-ce pas le retour à l’époque où le secteur privé s’engageait bénévolement au service de l’Etat ?
Lord Skidelsky a une particularité, celle d’avoir été mon professeur d’histoire économique à la Johns Hopkins University à Bologne au mitan des années 1970. Son grand ouvrage, la biographie officielle en trois tomes de John Maynard Keynes, est un chef-d’œuvre. L’ancien maître est ouvertement hostile à l’idée chère à Elliott d’une sorte de gouvernement de chefs d’entreprise agissant en coulisses : « Laisser la gestion de l’Etat au Big Business sous prétexte qu’il dispose de l’expertise technique du management et qu’il est soi-disant libre du parti pris politique est une grave erreur. Les hommes d’affaires ignorent la vie des gens et favorisent leurs amis. »
Aux yeux du pair indépendant, les liens étroits entre les magnats réactionnaires de la tech et l’administration Trump soulignent les conflits d’intérêts potentiels.
« Le libéralisme était naguère un mouvement cyclique, comme les vagues. La mondialisation est ainsi arrivée à marée haute, puis s’est retirée en attendant de revenir. Mais maintenant, les armes nucléaires, le changement climatique et la dépendance envers la technologie menacent l’avenir même de l’humanité ». Le pessimisme de Skidelsky est déconcertant.
Faute de parvenir à ralentir le rythme du changement, les exigences de protection prendront des formes totalitaires comme la montée actuelle de l’extrême droite le démontre, affirme le fin connaisseur de l’avènement du fascisme anglais dans les années 1930.
Pandémie. Robert me conseille de lire son bouquin de chevet, le dernier Ian McEwan, What we can know, sur la fin du monde causée par la guerre atomique, les inondations et la pandémie. Le best-seller de l’un des romanciers les plus importants de sa génération se lit comme une suite de tristes variations sur les difficultés de l’heure.
L’idée est de faire confiance à la chance pour la suite. Comme Keynes s’est battu toute sa vie pour la liberté sous toutes ses formes, pourquoi ne pas explorer la « Magna Carta », la Grande Charte, pierre angulaire des prémices de la démocratie parlementaire ?, suggère Skidelsky.
Le traité de paix signé en 1215 entre les barons et le roi Jean sans Terre sera ma prochaine étape. D’autant que parmi les signataires figuraient plusieurs personnages nommés… Keynes. Les Anglais ont décidément un sixième sens, et c’est celui du nonsense !
(*) : Mathhew Elliott, Michael Hintze, Arthur Laffer et Douglas McWilliams, Bitebackpublishing, 2025.
Pèlerinage au berceau du libéralisme : la Magna Carta, le retour de l’âge d’or
Publié le 29 décembre 2025 à 07:00
Salisbury, à deux cents kilomètres au sud-ouest de Londres, possède un centre-ville charmant et romantique avec ses petites rues commerçantes colorées. Au milieu d’une pelouse immaculée se dresse la majestueuse cathédrale gothique du XIVe siècle dont la flèche de 123 mètres de haut est la plus haute du pays. La basilique abrite la figure par excellence du libéralisme : la « Magna Carta ».
A l’inverse de Notre-Dame de Paris, l’accès est payant (11 livres soit 12,6 euros) dans ce sanctuaire de la libre-entreprise. Un quart de million de visiteurs se pressent chaque année dans ce « must » des guides touristiques pour admirer l’original du texte qui est au monde anglo-saxon ce que la Déclaration des droits de l’homme de 1789 est à la France.
La « Magna Carta » a été signée en 1215 entre le roi Jean sans Terre et des barons en rébellion contre les taxes supplémentaires destinées à financer sa guerre contre la France. Affaibli par la défaite de Bouvines survenue un an auparavant contre le roi Philippe Auguste, le souverain haï avait été contraint d’accepter la création d’un grand conseil des seigneurs doté du pouvoir d’approbation de l’impôt. Jugulant l’absolutisme royal, l’assemblée préfigure la naissance du Parlement.
Le document est présenté au centre de la salle capitulaire ornée de scènes de l’Ancien Testament. La pièce, où se réunissaient les moines, accueille un petit musée où est exposée la page écrite sur vélin, une peau d’agneau mort-né blanche, en vertu de la coutume archiviste ancestrale. La patente porte le sceau de Jean sans Terre. Les petits caractères rédigés en latin sont indéchiffrables.
La mieux conservée parmi la poignée de copies rescapées sur les 250 distribuées à l’époque aux monastères est visible dans l’obscurité qu’impose sa conservation.
Grâce aux protections établies par ce protocole, le système juridique anglais jurisprudentiel est devenu l’étendard du commerce mondial. La Grande Charte s’applique aujourd’hui encore à travers le Commonwealth, la grande famille d’outre-mer, de l’Australie à l’Inde.
Parmi les 63 clauses qui ont une grande résonance huit siècles après leur rédaction, quatre demeurent incorporées dans la législation anglaise. Annulé par le Vatican puis rétabli un an plus tard dans une version édulcorée par Henri III, le traité a toutefois été occulté par l’Habeas Corpus (1679), le Bill of Rights (1689), le Reform Act (1832) ou la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948) édictés par la suite.
Reste que la « Magna Carta » ne cesse d’être portée par l’actualité.
Ainsi, les opposants au projet du gouvernement travailliste de supprimer le recours au jury en vue de désengorger les tribunaux invoquent à l’appui de leur combat la célèbre clause 39 : « Aucun homme libre ne sera arrêté ni emprisonné, dépossédé de ses biens, ou déclaré hors-la-loi, ou exilé, ou exécuté de quelque manière que ce soit, et nous n’agirons pas contre lui et nous n’enverrons personne contre lui, sans un jugement légal de ses pairs et conformément à la loi du pays ».
De même, l’un des principaux inventeurs de l’Internet, Tim Berners-Lee, a lancé une campagne contre les géants du net en invoquant la « Magna Carta du web ». Le pionnier de la Toile exige des Meta, Google et consorts qu’ils protègent davantage la vie privée de leurs clients et acceptent de rendre leurs algorithmes plus transparents.
A l’écouter, c’est une question de vie ou de mort pour l’humanité dont l’avenir est autant menacé par la technologie que par l’arme nucléaire ou le changement climatique.
Enfin, la liberté d’expression est profondément enracinée dans la « Magna Carta ». Or, selon l’administration américaine, la liberté de parole est bafouée dans la plus vieille des démocraties en raison du wokisme qui ferait des ravages outre-Manche. Donald Trump affirme haut et fort que la « cancel culture » britannique fait taire les points de vue jugés indésirables par la gauche bien pensante et met au ban celui ou celle qui les ont exprimés.
A priori, le locataire du Bureau ovale a raison. Il n’y a qu’à se promener dans un endroit mythique de Londres où Marx, Lénine, George-Bernard Shaw et tant d’autres aimaient se rendre le week-end : le Speakers’ Corner ou le coin des orateurs de Hyde Park. Depuis plus de cent cinquante ans, n’importe qui peut y tenir n’importe quel discours juché sur une caisse ou un escabeau.
En ce dimanche matin, des prosélytes imprégnés de leur mission, deux prêcheurs islamistes, un militant propalestinien, un partisan de la tenue d’un référendum sur l’immigration musulmane et un illuminé haranguent un public parsemé et indifférent. L’agora, incarnation même de la tradition d’échanges intellectuels et de la tolérance, est moribonde.
N’empêche, la défense de la liberté de parole a actuellement le vent en poupe.
Ainsi, la police londonienne a fait savoir qu’elle refuse désormais de contrôler « les débats de la confrontation culturelle toxique ». Scotland Yard ne poursuivra plus ceux qui ont été l’objet de dénonciations pour des délits haineux non criminels par les militants de causes diverses, des trans aux propalestiniens en passant par les zélotes de la lutte contre le changement climatique.
De surcroît, les prud’hommes ont dernièrement donné raison à un actuaire licencié par son organisation professionnelle pour avoir qualifié le prophète Mohammed de « monstre » dans plusieurs tweets. Selon le verdict, l’acte sur l’égalité de 2010 protège bel et bien les convictions critiques de l’islam. Fondé par le pamphlétaire aux idées dérangeantes, Toby Young, la Free Speech Union, a payé les émoluments de ses avocats.
Il faut passer un certain temps dans la campagne autour de Salisbury, quintessence de l’Angleterre traditionnelle, pour pour constater que les classes supérieures vivent dans une bulle. La « Magna Carta » a marqué la victoire d’une classe, les féodaux, pas du peuple. Elle défend les privilèges des squires, les hobereaux, la gentry des champs qui tient toujours le haut du pavé dans le comté du Wiltshire.
Of course, cet univers à part regarde avec suspicion les Londoniens jouant aux grands propriétaires terriens. La comédienne Elizabeth Hurley, ancienne compagne de l’acteur Hugh Grant, a fait l’expérience de cet antagonisme. Lors d’un dîner chez une grande famille de la région, une invitée a demandé à la jeune Anglaise, blanche, si elle était… pakistanaise en précisant d’un ton égal que « quiconque n’a pas vécu ici depuis au moins trois générations est considéré comme pakistanais ».
En mars sera célébré le 250e anniversaire de la publication par Adam Smith de La richesse des nations. Quatre mois plus tard, les Etats-Unis fêteront la déclaration d’indépendance du 4 juillet 1776. Symbole de la lutte contre l’arbitraire, la « Magna Carta » avait inspiré les Pères fondateurs de la république en remplaçant le sujet par le citoyen.
Pour prendre la mesure du lien bilatéral historique, un déplacement à Runnymede s’impose. C’est en effet dans cette prairie aquatique, le long de la Tamise, dominée par le château royal de Windsor, qu’a été signé l’accord entre le monarque et la noblesse.
Le site est une parcelle de terre américaine. La construction du mémorial destiné à commémorer la Magna Carta, « personnification de la liberté », a été payée par l’association du barreau d’outre-Atlantique. Le style néoclassique, le dôme et les piliers rappellent davantage le Jefferson Mémorial de Washington que la statue de Nelson !
A quelques encablures de là, a été posée l’immense pierre de sept tonnes dédiée au président John Kennedy. Dans le café, un hommage à Franklin .D. Roosevelt rappelle sa déclaration lors de l’inauguration de son troisième mandat au début 1941 : « L’aspiration à la démocratie n’est pas seulement une phase récente de l’histoire humaine. Elle a été écrite dans la Magna Carta ». Entre 1939 et 1945, le parchemin avait été d’ailleurs évacué par précaution à Fort Knox et placé dans la chambre forte la plus sécurisée hébergeant les réserves d’or de l’oncle Sam pour échapper au Blitz.
Tout au long de mon pèlerinage aux sources du libéralisme, j’ai confié mon sort au hasard en demandant à chacun de mes interlocuteurs de me suggérer la personnalité, le lieu ou le monument emblématiques. A ce stade, après mon exploration de la « Magna Carta », je me retrouve le stylo en l’air.
Heureusement, The Economist, lecture obligée du week-end, est venu à ma rescousse. Depuis 1843, la devise du fondateur de l’austère hebdomadaire, James Wilson, est publiée sous le sommaire en tout petits caractères : « Prendre part à cette rude bataille opposant l’intelligence, qui va de l’avant, à l’ignorance indigne et timide qui entrave notre progrès ».
Pèlerinage au berceau du libéralisme : « The Economist », my weekly is rich, very rich
Publié le 30 décembre 2025 à 09:15
Voici l’archétype de la femme moderne, élégante et intelligente. L’œil est séduisant, la voix suave comme un chocolat « Quality Street ». Mais que cache cette veine qui saille au centre du front quand l’attention se fait forte ? Zanny Minton Beddoes est aussi très habile. La première femme à diriger l’hebdomadaire The Economist, l’un des titres les plus prestigieux de la planète, manie la réplique avec circonspection comme autant de boomerangs qui pourraient lui revenir.
A l’image des mèches blondes dont aucune ne volette autour du visage avenant, pas un mot ne dépasse au cours de notre conversation dans le bureau banal dominant la Tamise, fleuve fétiche du commerce planétaire.
Zanny Minton Beddoes, telle qu’en elle-même, se situe entre la cité juste de Platon et la prudence d’Aristote. A l’instar de The Economist, fondé en 1843 par James Wilson, un industriel lainier socialement progressiste, en vue de soutenir le mouvement d’abrogation des lois sur le blé. La revue se définit comme libérale au sens classique du terme, c’est-à-dire fidèle à la pensée d’Adam Smith, l’auteur de « Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations » dont on célèbrera en mars 2026 le 250e anniversaire de la parution.
« Ma conception n’est pas idéologique, mais s’enracine dans un examen rigoureux des évènements. Nous sommes en faveur du libre-marché, d’un rôle restreint de l’Etat, de la liberté individuelle, du libre-échange. La raison et le débat d’idées permettent le progrès », explique mon interlocutrice au self-control empreint de froideur comme il sied à une executive woman.
Le tropisme libéral s’applique également à la politique étrangère qu’atteste par exemple le soutien à l’Ukraine au nom de l’affrontement avec la tyrannie sous toutes ses formes. Sur les sujets de société, la défense du mariage gay, la décriminalisation des drogues et l’euthanasie sont à l’ordre du jour.
Sur le plan de la vie des affaires, de la politique et du sociétal, le magazine basé à Londres, exclusivement anglophone mais profondément global, vendu dans 211 pays, est d’une remarquable constance.
Ses deux prédécesseurs, Bill Emmott et John Micklethwait, ont guidé The Economist lors des années glorieuses de la mondialisation. Minton Beddoes a pris les commandes en 2015. Depuis, le paysage s’est profondément transformé avec le Brexit, Donald Trump, l’émergence de nouvelles puissances, la montée de régimes autoritaires, le retour de la Guerre froide, l’explosion des médias sociaux et de l’intelligence artificielle.
Il a été complètement modifié par les politiques de re-règlementation financière et du retour de l’Etat providence à la suite de la déroute des subprimes de 2008 dont The Economist n’avait pas prévu l’ampleur.
Comme la majorité de sa rédaction, la dame bon chic à l’accent distingué n’a pas utilisé la filière habituelle du métier en Angleterre, consistant à s’initier dans une agence de presse ou dans des journaux locaux.
Après s’être aguerrie en travaillant aux côtés de Jeffrey Sachs, l’apôtre de la « thérapie de choc » destinée à sortir les anciennes contrées communistes de la crise qu’elles connaissaient, et un bref passage au Fonds monétaire international, la diplômée d’Oxford et d’Harvard a été recrutée en 1994.
Après avoir planché sur les marchés émergents, la nouvelle venue est envoyée aux Etats-Unis comme correspondante économique pendant près d’une décennie. The Economist a toujours préféré des universitaires, des experts ou des historiens qui, pour reprendre les premiers mots de la devise du journal, « ont pris part à une lutte sans merci entre intelligence(s) » aux professionnels formés sur le tas ou dans les écoles de journalisme.
Ce n’est pas une carrière que la dirigeante mène mais un marathon. Les rendez-vous se chevauchent, sautent les frontières, enjambent les continents.
Sans nul doute, Zanny-la-bienheureuse a fait du bon travail. Avec 1,3 million d’abonnés aux quatre coins du globe, 270 millions de visiteurs du site et un formidable potentiel de progression, le succès insolent de The Economist ne se dément pas alors que le secteur broie du noir.
En 2024, l’entreprise sise dans un immeuble art deco de John Adam Street, proche du Strand, peut se targuer de revenus, de bénéfices et de nouveaux abonnés records. Le groupe privé, dont le principal actionnaire est John Elkann (46 %), l’homme fort de Stellantis et d’Exor, holding d’investissement de la famille Agnelli, s’offre le luxe d’embaucher, d’innover, de se répandre à travers le monde.
A l’évidence, en dépit d’un prix de vente élevé, les lecteurs apprécient les articles ciselés par les 300 scribes salariés, dont un tiers sont déployés à l’étranger dans 26 bureaux, et bon nombre d’indépendants.
Le succès aux Etats-Unis, de loin le premier marché d’exportation, est d’autant plus remarquable qu’il s’agit de consommateurs difficiles à séduire. On ne compte plus les investisseurs étrangers à s’y être cassé les dents. Par ailleurs, le refus de s’identifier au parti démocrate ou républicain, l’ouverture sur les questions de mœurs et l’humour distancié auraient pu rebuter la clientèle d’outre-Atlantique. Sans parler d’une même édition diffusée sous toutes les latitudes, sans aucune adaptation au lectorat local, si ce n’est l’ordre des rubriques et la couverture.
Il n’en a rien été. The Economist a indéniablement su tirer profit de son extraction britannique, synonyme de sophistication. Comme l’explique l’analyste des médias Claire Enders, « pour les PDG américains, c’est la lecture obligatoire pour savoir ce qui se passe en Europe et en Asie. La force de la marque est son prestige lié notamment à sa longue histoire. »
L’écriture, concise, précise, dépourvue de clichés, constitue un grand atout. Le « style book », le livre sacré, reprend à son compte la langue claire et simple chère à l’écrivain George Orwell, le héraut de l’antitotalitarisme. En outre, le culte de l’anonymat des signatures en vigueur à dater de la création de l’hebdomadaire est au cœur de l’identité de l’enseigne rouge et blanc. La culture collégiale évite les batailles d’ego et de chapelles, facilite le travail et donne une égalité de ton. La tradition d’incognito est toutefois battue en brèche de nos jours par les podcasts, notes de blogs, vidéos, médias sociaux ou apparitions de rédacteurs à la télévision.
De surcroît, le modèle commercial s’appuie sur les abonnés qui représentent les trois quarts du chiffre d’affaires, la publicité un gros quart. Le profil des clients – jeune, appartenant à 80 % aux tranches supérieures de revenus, aux goûts haut de gamme, travaillant dans un large éventail professionnel – est particulièrement prisé par les chargés de placement média.
D’autre part, à l’inverse de la concurrence, le contenu en ligne a été payant dès le départ. Les podcasts sont destinés uniquement aux abonnés tout comme l’app Expresso, la synthèse chaque matin de l’actualité, générée par l’intelligence artificielle, disponible en anglais tout comme en chinois, espagnol, français et allemand.
On cherche des réserves à la belle histoire que la patronne nous a racontée de long en large.
« – Vous avez connu des échecs ?
– Plein [rires], sans donner davantage de détails au-delà d’un petit mea culpa, « nous aurions pu mieux analyser la raison pour laquelle les autocrates ont la cote auprès d’une grande partie de la population au lieu d’expliquer, au risque d’en indisposer, que le Brexit et Trump étaient de mauvais choix. »
Ses détracteurs raillent volontiers le côté « je-sais-tout » et s’en prennent aux pratiques de donneur de leçons d’une institution parfois rétive à reconnaître ses erreurs. A commencer par les bienfaits de la mondialisation montés en épingle sans états d’âme pendant des lustres.
Au visiteur friand de drames et qui aimerait bien lui faire dire que la paralysie politique actuelle de la France est catastrophique à long terme, l’observatrice francophile et francophone répond que le pire n’est jamais sûr. A ses yeux, l’Europe en général, principal bénéficiaire de l’ordre issu de 1945 sous l’égide de Washington, est incapable de mettre en place les réformes nécessaires pour assurer la croissance, rétablir l’équilibre fiscal et réduire la dette. Augmenter l’impôt et les dépenses sociales n’est pas soutenable.
« Il est temps pour le libéralisme de se réinventer et de revenir à ses sources, le combat pour la réforme, au lieu de tenter de préserver le statu quo ». Son Excellence m’invite à lire le « manifeste du renouveau du libéralisme » qu’elle a écrit en 2018 à l’occasion des 175 ans de la noble maison. Tout y est, paraît-il, dit.
Que fait le pèlerin obligé de décrypter la bible de quatorze pages écrites en petits caractères par Zanny Minton Beddoes ? Bon sang mais c’est bien sûr ! Ma prochaine étape est la London School of Economics, l’alma mater de l’incontournable Friedrich Hayek, l’un des penseurs les plus importants du XXᵉ siècle.
Pèlerinage au berceau du libéralisme : Les riches heures de Friedrich August von Hayek
Publié le 31 décembre 2025 à 10:34
Retour au point de départ de mon pèlerinage au berceau du libéralisme, la National Portrait Gallery. Le voyage dans le temps proposé par le panthéon des gloires du royaume est la meilleure introduction possible à Friedrich August von Hayek (1899-1992). C’est en frissonnant presque d’émotion que l’on découvre la peinture du théoricien du libre-marché et croisé des droits de l’individu aux cimaises de la salle 28 située au deuxième étage du musée de Trafalgar Square.
Le visage pensif un peu las, le sourcil gauche levé en signe d’ironie, les cheveux blancs soigneusement peignés et les fines lunettes couleur or dégagent une impression de puissance intellectuelle. Mais tout est dans l’œil, à la fois sérieux et amusé de celui qui avait qualifié l’Etat-providence « de distributeur de services glissant fatalement vers le socialisme aux méthodes coercitives et essentiellement arbitraires ».
Le portrait de Keynes (1883-1946), son adversaire numéro un, est pendu dans la salle voisine. Le champion de l’intervention de la puissance publique semble sortir d’un songe, désabusé, une cigarette à la main, tenant nonchalamment un livre. Le contraste est saisissant.
Hayek-Keynes ! Une comparaison insupportable pour l’un comme pour l’autre !
En effet, tout oppose l’immigré autrichien, secret, rigide dans ses convictions et coincé, au pilier du légendaire groupe artistique bohème de Bloomsbury rassemblant artistes et intellectuels dans les années 1930, bon vivant, objecteur de conscience, homosexuel et hypocondriaque.
Autre différence entre les deux stars, Hayek a reçu le Nobel d’économie en 1974, conjointement avec Gunnar Myrdal, pour sa recherche sur les fluctuations conjoncturelles. Son concurrent a raté à trois reprises l’ultime marche du podium du prix de la paix pour ses travaux sur les conséquences économiques du traité de Versailles, en 1919. En outre, la Société du Mont Pèlerin fondée en 1947 par le polémiste en vue de défendre les valeurs libérales réunit le gratin du business international et les dirigeants de la planète.
Et puis, il y a des choses qui ne se pardonnent pas. Keynes, pur produit de l’université de Cambridge, a enseigné dans cette vénérable citadelle du savoir aux collèges gothiques fondée au XIIIe siècle. Entre 1931 et 1950, Hayek a été professeur d’économie et de statistiques à la London School of Economics (LSE). L’école a été fondée à la fin du XIXe siècle par la Fabian Society, club politique de gauche.
Cette querelle académique des Anciens et des Modernes sur fond de lutte des classes est absolument, essentiellement, désespérément anglaise. N’empêche, malgré leur antagonisme intellectuel, les deux hommes étaient amis, comme l’étaient au demeurant deux autres frères ennemis de l’autre côté du Channel, Raymond Aron et Jean-Paul Sartre.
En 2020, un cycle de conférences et de recherche consacré à l’œuvre de Hayek a été créé par d’anciens élèves inquiets de la marginalisation du chantre de la liberté par un corps professoral largement keynésien. Les pressions des étudiants étrangers, en particulier chinois (18 % des 13 000 inscrits), passionnés par la vulgate libérale, expliqueraient le retour au premier plan du philosophe très contesté dans le contexte international de l’après-guerre.
A écouter Sir Tim Besley, responsable de ce programme, l’apôtre d’une politique monétaire restrictive pour lutter contre l’inflation – le mal absolu – est toujours pertinent en ces temps d’envolée du coût de la vie. Quant à l’article de référence de Hayek, Scientisme et société sur l’abus de la raison, il est au cœur du débat actuel sur le rôle du marché et les raisons de sa performance supérieure à celle de l’Etat.
Enfin, mon interlocuteur a dirigé un livre collectif intitulé le London Consensus dressant les « principes économiques pour le XXIe siècle » basés sur « une ligne de pensée largement libérale qui remonte aux Lumières. Elle repose sur une philosophie politique et sociale qui met l’accent sur les droits individuels et l’accès ouvert aux marchés ». Le titre du rapport est tiré du fameux « Consensus de Washington » porté par le FMI et la Banque mondiale avant d’être adoubé par Ronald Reagan et Margaret Thatcher.
A la LSE, aucune toile ni buste ne rend hommage à Hayek, esprit unique, multiforme et complexe. Le nom de l’une des figures clés du XXe siècle figure seulement sur le mémorial au côté de la vingtaine d’autres lauréats du Nobel moulés en ce lieu. Les gourous ne font plus recette. En cause, le règne des maths, des algorithmes, des données, de l’empirisme et des preuves qui ont « nettoyé » la macro-économie des controverses. La profession d’économiste s’est atomisée.
Ce n’est pas tout. Lors de l’apogée de la « cancel culture », le natif de Vienne devenu citoyen britannique en 1938 a été l’homme à abattre. En 2021, un groupe d’étudiants trotskystes a lancé une campagne de boycottage d’Hayek sous prétexte qu’il était « nuisible à la santé mentale des étudiants de milieux défavorisés ». A l’appui de leur pilonnage visant un penseur jugé inconvenant, les militants anticapitalistes ont invoqué son soutien à la politique économique ultra-libérale suivie au Chili par les adeptes du laisser-faire le plus féroce. N’avait-il pas déclaré au Times en 1978 que « sous la dictature de Pinochet, il y avait bien plus de liberté que sous le gouvernement démocratique, populiste et socialiste d’Allende » ?
Si l’attaque des « trots » s’est vite dégonflée, ils ont pris leur revanche l’année suivante. La municipalité travailliste de Camden, bastion de l’extrême gauche, a bloqué le projet de la Hayek Society, la société étudiante qui lui est dédiée, d’ériger une statue en l’honneur de leur idole dans le square Lincoln’s Inn Field jouxtant l’école.
« Je ne suis pas au courant. Ça s’est passé avant mon arrivée en 2024 », insiste Larry Kramer. Le président et vice-chancelier de la LSE présente une caractéristique assez rare, il ressemble à son curriculum vitae trouvé sur Wikipédia. L’ancien responsable des facultés de droit à l’université de Chicago puis à Stanford y est défini comme progressiste.
« Dans le libéralisme, la manière dont l’Etat et le marché sont imbriqués, un lien évoluant constamment selon la nature de l’économie et de la société, compte avant tout. Même Adam Smith considérait que l’Etat jouait un rôle contre les excès du capitalisme sans entrave » : rien n’illustre mieux la langue de bois que sa définition à l’eau tiède de la doctrine de Hayek.
Docte et sentencieux (puisqu’il enseigne), l’universitaire au discours millimétré devient acide et véhément quand on mentionne l’appui de nombreux patrons de la high tech à Donald Trump. Du haut de son magistère, le chef de la LSE dénonce leurs motivations profondes qui ne sont autres que la promotion des intérêts de leur business. En clair, Trump leur a permis d’être égoïstes sans aucun sentiment de culpabilité.
Alors que je suis en costume cravate, l’intéressé est habillé d’un moche pull gris à col en V. Larry Kramer a le style Silicon Valley jusqu’à la caricature. Avant de s’installer à Londres, mon hôte a dirigé pendant une décennie la Hewlett Packard Foundation créée par la multinationale de l’informatique pour œuvrer en faveur de l’éducation, l’environnement, l’équité des genres et la justice raciale.
Il a tiré de son association avec « HP » une expertise de l’intelligence artificielle (IA). A ses yeux, l’humanité doit trouver rapidement le point d’équilibre entre les dangers de destruction d’emplois et les apports de l’IA en matière d’innovation et de création d’emplois pour sortir de l’ornière. Toujours le juste milieu, synonyme pour Hayek, de l’abandon des convictions, des principes et des valeurs, bref de l’impuissance.
Dans cette série, j’ai choisi de faire confiance à l’arbitraire. Dans le métro du retour, un homme à la soixantaine élégante, mince, sec comme une trique, lit le Financial Times. Le gentleman au parapluie sous le bras et à la serviette de cuir fatigué descend comme moi à l’arrêt Charing Cross. Je le suis jusqu’à Pall Mall.
Et si c’était lui ? A force de me plonger dans l’œuvre de Hayek, je le vois partout. L’élégant patricien s’engouffre dans son club privé, le Reform, niché dans un bâtiment ressemblant à un palais vénitien. Hayek était membre du même sanctuaire de l’establishment, non pas par snobisme, mais en raison du niveau intellectuel des membres, de leurs conversations et de leur compagnie agréable. Sa photo en noir et blanc est d’ailleurs exposée dans le grand escalier aux côtés des autres éminents adhérents.
Sur les traces des lieux emblématiques du libéralisme, les fameux clubs londoniens, dont le nom ne figure jamais au fronton, sont incontournables.
Pèlerinage au berceau du libéralisme : la renaissance des « gentlemen clubs » ou le charme discret du gris flanelle
Publié le 5 janvier 2026 à 08:00 – Maj 5 janvier 2026 à 07:59
Salle à manger aux portes matelassées, fumoir aux divans profonds, bibliothèque bourrée de livres richement reliés, lourdes pendules où batifolent des angelots, chandeliers d’époque et tapis laminés : Gordon Fishman aime le décor vieillot du National Liberal Club (NLC) narrant l’histoire d’Angleterre. Le président de cette institution plus que centenaire nichée à deux pas de Trafalgar Square manifeste de l’affection pour les 2 653 membres – « des amis », laisse-t-il échapper – qui soulignent tous son dévouement.
« Je suis d’obédience libérale depuis l’adolescence, à l’instar de mes parents, ouverts d’esprit, généreux, attachés à la défense de la liberté et de l’égalité face au collectivisme socialiste et à l’égoïsme des conservateurs » : il faut en effet avoir la foi pour militer au vieux parti libéral britannique rebaptisé « lib-dem » après sa fusion avec des transfuges du Labour. Créée en 1830 par les whigs hostiles aux hiérarchies héritées de la propriété foncière et favorables aux innovateurs et aux réformes sociales, la formation centriste est devenue le Tom Pouce de la vie politique après la Première Guerre mondiale. Tirant profit du système de vote uninominal à un tour donnant la victoire au candidat arrivé en tête quel que soit le pourcentage de voix, les deux mastodontes, conservateur et travailliste, ont pratiqué l’alternance au 10 Downing Street au détriment de la troisième force.
Comme il paraît bien loin l’âge d’or. C’était à la fin du XIXe siècle lorsque William Gladstone, dont le portrait trône dans le salon d’attente, avait été Premier ministre de la reine Victoria à quatre reprises. Depuis Lloyd George entre 1916 et 1922, les libéraux n’ont été qu’une seule fois associés au pouvoir, entre 2010 et 2015, dans le cadre d’une coalition avec les tories de David Cameron. L’aventure gouvernementale avait été par la suite électoralement désastreuse en raison de la politique d’austérité impopulaire auprès de leur base.
Dans son récent opuscule, Liberalism, Jonathan Parry, professeur d’histoire à l’université de Cambridge, affirme que « le rassemblement sans programme bien défini a conservé une culture radicale, opposée à la concentration du pouvoir par les élites et au nationalisme tout en appuyant les droits de l’individu et la liberté d’expression ». En faisant entendre sa différence, le mouvement cherche à séduire ceux qui ne se reconnaissent ni dans la droite, encore moins dans l’extrême droite, ni dans la gauche et les verts.
Reste que de sa splendeur passée, le NLC n’a conservé que le siège de l’internationale libérale regroupant aujourd’hui 90 affiliés à travers le monde. Depuis des lustres, le sanctuaire de la confrontation des idées n’abrite plus les intrigues politiciennes.
Avec sa bedaine avenante, son accent du Nord ouvriériste et son bon sens, Fishman a l’air pataud mais sa finesse est bien cachée. Un doux amateur ne serait jamais parvenu à redresser au forceps une institution financièrement mal en point en raison des erreurs de gestion et du vieillissement de ses souscripteurs. Lors de notre visite, les membres s’agglutinaient au bar, massés debout, dans une bousculade de bon aloi, et le restaurant affichait complet.
On les croyait en effet condamnés, les célèbres clubs londoniens, dépassés par les bouleversements économiques et sociaux d’une capitale jeune et cosmopolite. Pourtant, les dinosaures jadis de la stricte stratification sociale se portent à merveille. Dans les immeubles classiques de Pall Mall et de St James, les bénéfices sont de retour, les listes d’attente s’allongent et la clientèle ne cesse de rajeunir.
C’est le cas non seulement du NLC, mais aussi du White’s, l’ancêtre fréquenté par la haute aristocratie, les officiers et le clergé, du Reform, haut lieu des professions libérales, du minuscule Beefsteak, où tous les serveurs sont appelés Charles, du Garrick, QG des artistes et des journalistes, hanté paraît-il par un fantôme, ou de l’Athenaeum, refuge de la haute fonction publique et du barreau.
Les apparences superbement immuables de ces havres de paix cachent une révolution tranquille. Désormais, le secrétaire est un professionnel de l’hôtellerie et de la restauration. Les cotisations – entre 1 000 et 4 000 livres par an, soit 1 142 à 4 568 euros – proposent des réductions pour étudiants, les moins de 40 ans et, dans certains cas, des tarifs dégressifs selon l’heure de fréquentation.
La nourriture roborative d’antan a fait place à des plats dignes des bonnes tables londoniennes. Le choix des vins a été élargi au-delà du claret maison à toute la palette des crus de la planète. Les tarifs des nuitées dans les établissements qui possèdent des chambres à coucher, simples mais confortables, restent inférieurs de moitié à ceux des hôtels du quartier. De plus, les accords de réciprocité avec des clubs similaires aux quatre coins du globe constituent un attrait supplémentaire aux yeux d’une gente voyageuse.
Le « dress code » a évolué au plus grand dam des tenants du conservatisme vestimentaire. La cravate n’est plus obligatoire mais seulement conseillée, les tenues de sport et les jeans sont toutefois bannis. Le téléphone portable n’est plus passible d’exclusion tant qu’on l’utilise dans les endroits réservés. Il est toujours interdit de consulter des documents professionnels dans la salle à manger ou au bar, mais des espaces de travail sont à la disposition des businessmen.
Surtout, ces bastions de la haute société blanche, protestante et anglo-saxonne se sont ouverts aux minorités ethniques. Le NLC a été le premier des clubs à embrasser la grande cause de la diversité raciale et religieuse. Il est bien révolu le temps où les seuls visages noirs, arabes et asiatiques étaient ceux du personnel.
Ce souci d’inclusivité, le NLC l’a également démontré en acceptant, avant les autres, les femmes exclues au départ de ces forteresses de la suprématie masculine. Aujourd’hui, sur les 48 adhérents de The Association for London Clubs, moins d’une dizaine ne sont toujours pas mixte sous prétexte, comme l’affirme un responsable, que « la présence des femmes risque de rompre l’harmonie d’un lieu fondé sur l’amitié masculine et la discrétion en toutes choses ». Pas question de se formaliser, j’ai entendu pire remarque machiste de la part d’habitués à la trogne rubiconde et dilatée, un énième verre de blanc haut perché à la main.
Le retour en vogue est également lié à la persistance d’un certain snobisme. « Ici, on appartient à la même tribu, ce qui met de l’huile dans les rapports humains. C’est l’un des rares endroits où l’on peut nouer des relations agréables dans une ambiance décontractée et en toute discrétion. Vous êtes abrité du dehors », susurre un directeur. Le code personnel impose des exigences de politesse, de courtoisie, de charme. Il faut être un bon compagnon, « clubable », selon le jargon. Dans un univers sans repères, où se sont effondrées certitudes et conformismes, les valeurs colportées servent à nouveau de référence.
La preuve, les entrepreneurs surfent sur la popularité des clubs traditionnels en faisant fructifier leur modèle à la patine inimitable nulle part semblable. Selon Seth Alexander Thévoz, auteur de London Clubland, aux côtés des cénacles anciens sans but lucratif existent 78 entités purement commerciales créées depuis 1985. L’an prochain, une bonne dizaine doivent ouvrir leurs portes. Dont le futur Pembroke club, face à Buckingham Palace, financé par le duc de Westminster, le plus gros propriétaire terrien de la capitale, et le fonds souverain d’Oman. Le ticket d’entrée est d’un million de dollars !
Dans le lounge du Groucho Club, réservé aux professionnels des médias, une faune de jeunes gens en jeans, baskets ou – pire – sweat à capuche, pianotent sur un ordinateur portable, jouent avec un terminal de poche ou consultent une tablette. Les conversations sont bruyantes et la familiarité est de rigueur. La sélection y est tout aussi rigoureuse, seuls les critères diffèrent. La réputation professionnelle importe, pas l’origine sociale ou l’argent parental. Le nom de cette institution sise à Soho, en plein ghetto gay, est un clin d’œil au comique américain Groucho Marx qui avait déclaré un jour : « Je ne voudrais jamais adhérer à un club qui compte parmi ses membres des types dans mon style. »
Que choisir pour la dernière étape de mon long périple aux sources du libéralisme ? L’objectif de la série est de retrouver les lieux et les personnages de cette incroyable odyssée. En relisant ma copie, une évidence surgit. Le sujet de l’épilogue sera Margaret Thatcher, le prototype de la vraie libérale. Pendant une décennie, elle a agi comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Avec « la dame de fer » comme fil rouge, la boucle est bouclée.
Pèlerinage au berceau du libéralisme : Thatcher forever ? Souveraine « Maggie »
Publié le 5 janvier 2026 à 12:20
Clap de fin ! Eteignez les spots. Pour le dernier épisode de ma visite guidée du berceau du libéralisme, un périple sur les lieux emblématiques du parcours de l’ex-Première ministre Margaret Thatcher, aux affaires entre 1979 et 1990, s’impose. La première femme à occuper le 10 Downing Street a agi à l’instar d’un éléphant dans un magasin de porcelaine en vue de redresser une situation économico-sociale que quatre décennies d’intervention étatique avaient singulièrement compromise.
Le choix de finir par « Mrs T » est indiscutable. L’intéressée a dominé mes deux séjours londoniens, entre 1979 et 1981, et depuis 1985. Au lendemain de sa première victoire électorale, Reuters m’avait envoyé couvrir l’arrivée à « Number Ten ». Je me souviens de son sourire un peu mécaniquement figé et du menton relevé en défi. En 1985, j’avais retrouvé Londres en pleine grève des mineurs, apothéose de sa lutte sans merci contre les syndicats tout-puissants. Pendant cinq ans et par la suite, ses exploits et ses échecs ont rythmé ma correspondance au Royaume-Uni.
La meilleure manière de saisir cette personnalité hors norme est de sillonner la capitale à l’étage d’un bus touristique à impériale, « Hop on-Hop off » (monter et descendre), en s’arrêtant à dix stations symboles du formidable récit kaléidoscopique de ses trois mandats d’affilée.
Le premier arrêt du « double decker » parti de Notting Hill est l’échoppe-phare de la chaîne Marks & Spencer nichée à l’entrée d’Oxford Street. Margaret Thatcher achetait ses sous-vêtements dans cet emblème de la distribution réputé pour son bon rapport qualité-prix qu’elle admirait au point de proclamer après la chute du mur de Berlin que « Marks & Spencer ont triomphé de Marx &Engels » !
Décor blanc, parquet gris clair, collection standard dénuée de tout glamour : la grande surface n’a guère changé depuis que sa distinguée cliente venait y faire ses emplettes de lingerie fine. Reste que les soutiens-gorge et petites culottes affriolants placés en tête de gondole auraient choqué un être prude, commandé par la hantise toute protestante du péché.
Deuxième étape, la boutique « Aquascutum » du 24 Great Marlborough Street, rue perpendiculaire à Regent Street. La marque alliant qualité et discrétion a façonné le fameux « power dressing » (la garde-robe du pouvoir) de « Maggie » destiné à projeter une image d’autorité dans un univers politique machiste. Le look audacieux sans être extravagant ainsi que les couleurs acidulées mais jamais criardes de ses tenues faisaient ressortir son teint de pêche et le bleu de ses yeux. Inutile d’insister, l’enseigne culte a fermé ses portes pour faire place à un café italien.
Troisième arrêt, le Ritz sur Piccadilly. En 2013, elle est morte d’un AVC dans une suite du palace mise gratuitement à sa disposition par les propriétaires, David et Frederic Barclay. Après le décès de son mari Denis et l’apparition des premiers signes de troubles mentaux et de problèmes de mémoire, les jumeaux sont venus à la rescousse de la dirigeante déchue qui n’a jamais fait partie des possédants. En faillite en 2020, le cinq étoiles au charme désuet a été revendu à l’émir du Qatar. Le cadre est aujourd’hui tape-à-l’œil, clinquant, sans intérêt.
Empruntant Saint-James, le bus passe devant le Carlton Club, point d’ancrage des politiciens de droite. Le club « pour messieurs » a longtemps refusé l’admission de l’ancien sexe faible. Ce sanctuaire de l’upper class nourrie des plus vieilles traditions fut contraint de faire une entorse à son règlement d’airain et d’accueillir en 1975 la nouvelle cheftaine des tories. Heureusement pour les membres, l’élue détestait les « bavardages de femmes ». Maintenant, l’institution est mixte.
Direction le 10 Downing Street, la cinquième halte. Ma visite de son bureau du premier étage me revient à l’esprit en me mêlant à la foule des touristes agglutinés aux grilles protégeant la modeste maison de briques. L’hôtesse du Dix m’y avait reçu en compagnie d’une poignée de confrères lors de l’une de ses éternelles batailles contre le budget européen. La table de travail était libre de tout papier. La seule note personnelle était un vase rempli de fleurs des champs aux couleurs franches et affirmées.
De photos de famille, point. L’actuel chef du gouvernement travailliste, Keir Starmer, a fait enlever son portrait installé en 2009 sous prétexte que travailler sous l’œil réprobateur de l’ex-locataire était « trop déconcertant ».
Sixième pause, Parliament Square, à l’ombre de Big Ben, illustre l’engouement des Britanniques pour la guerre. Les statues de Churchill au côté de Disraeli, de Palmerston, de Cromwell et des généraux prestigieux tels Montgomery soulignent ce trait du caractère national. En revanche, aucun mémorial aux alentours ne rend hommage à la triomphatrice du conflit des Malouines contre la dictature argentine en 1982.
Visiblement, tout le monde n’a pas eu la larme à l’œil lors de sa démission sans gloire mais non sans panache. Une partie de l’opinion continue de l’abhorrer. Afin de les protéger des vandales, les deux figures, l’une en marbre, l’autre en bronze, existantes à Londres, trônent à l’entrée de la Chambre des Communes et à l’hôtel de ville de la City, gardés autant que Fort Knox.
Cap sur Soho pour la septième pause. Le célèbre quartier chaud a fait place nette des sex-shops, peep-shows et bar à entraîneuses réprouvés par la morale, appréciés par la libido, encouragés par l’ennui conjugal. Seule Old Compton Street, l’artère gay, a résisté à cette vision aseptisée. Les aficionados exècrent encore de nos jours la tenante des valeurs victoriennes, architecte de la législation rétrograde « clause 28 » interdisant aux écoles, collèges et lycées de « promouvoir » l’homosexualité en tant qu’alternative acceptable à une relation familiale hétérosexuelle. L’insensibilité et l’indifférence envers l’autre Angleterre des minorités et des laissés-pour-compte ont été le point noir de son bilan.
« Monument », la colossale colonne dorique élevée au cœur de la City pour commémorer le Grand incendie de 1667, est ma huitième borne. Le fameux Big Bang de 1986, la déréglementation totale et sans entrave de la finance a libéré une place ankylosée par ses coutumes et privilèges séculaires.
L’ouverture à la concurrence, ainsi que son grand chantier de construction de la city-bis de Canary Wharf sur les anciens docks ont permis de transcrire en anglais le mot entrepreneur. Margaret Thatcher n’a eu de cesse de combler le retard du deuxième centre boursier mondial après New York.
Surprise de la neuvième étape, l’autobus roule à droite à l’exemple du Vieux Continent, la seule exception au Royaume-Uni où l’on conduit à gauche, en empruntant la brève rue menant à la cour privée du « Savoy Hotel ». Il s’agissait de permettre aux cochers d’ouvrir la portière côté trottoir pour les passagers (surtout les dames) sans qu’ils aient à contourner le véhicule.
Cette coutume devait fortement déplaire à Margaret Thatcher, eurosceptique de cœur dont le restaurant préféré était le « Savoy Grill ». La petite mangeuse adorait la cuisine anglaise la plus classique, le service irréprochable, les boiseries sombres, les banquettes de velours et les tables rondes espacées pour garantir la confidentialité des conversations.
L’habituée aurait maudit la présente brasserie à l’atmosphère ouatée, suave. Seul, le nouveau patron du « Grill », le très médiatique chef Gordon Ramsay, self-made man brutal et impitoyable, aurait gagné sa faveur.
Enfin, Trafalgar Square. Me voilà revenu à mon point de départ, la National Portrait Gallery. A mon avis, le plus beau portrait officiel de Margaret Thatcher pend aux cimaises de ce musée des Britanniques les plus renommés. La toile montre la championne du capitalisme populaire s’adressant aux délégués du congrès conservateur de 1982 à Brighton. Le leader de la majorité arbore la panoplie de la bourgeoise anglaise bon genre mais aux moyens mesurés.
Hiérarque, le regard direct, un tantinet de morgue impériale, la maîtresse des assises est entourée de plusieurs ministres sages comme des enfants de chœur. Le message de son port de tête altier est sans ambages : pas question de se laisser intimider par quiconque.
Mon enquête est terminée. Ma conclusion ? La commémoration en mars 2026 du 250e anniversaire de la publication de la Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations d’Adam Smith tombe mal dans cette époque des populismes planétaires et du besoin de protection de l’Etat providence. Peut-être faudra-t-il attendre le 275e, voire le 300e anniversaire pour célébrer la consécration des principes édictés par le philosophe des Lumières écossais ? Mais je n’y serai plus. A nos jeunes lecteurs de s’emparer de cette magnifique idée.
FIN








